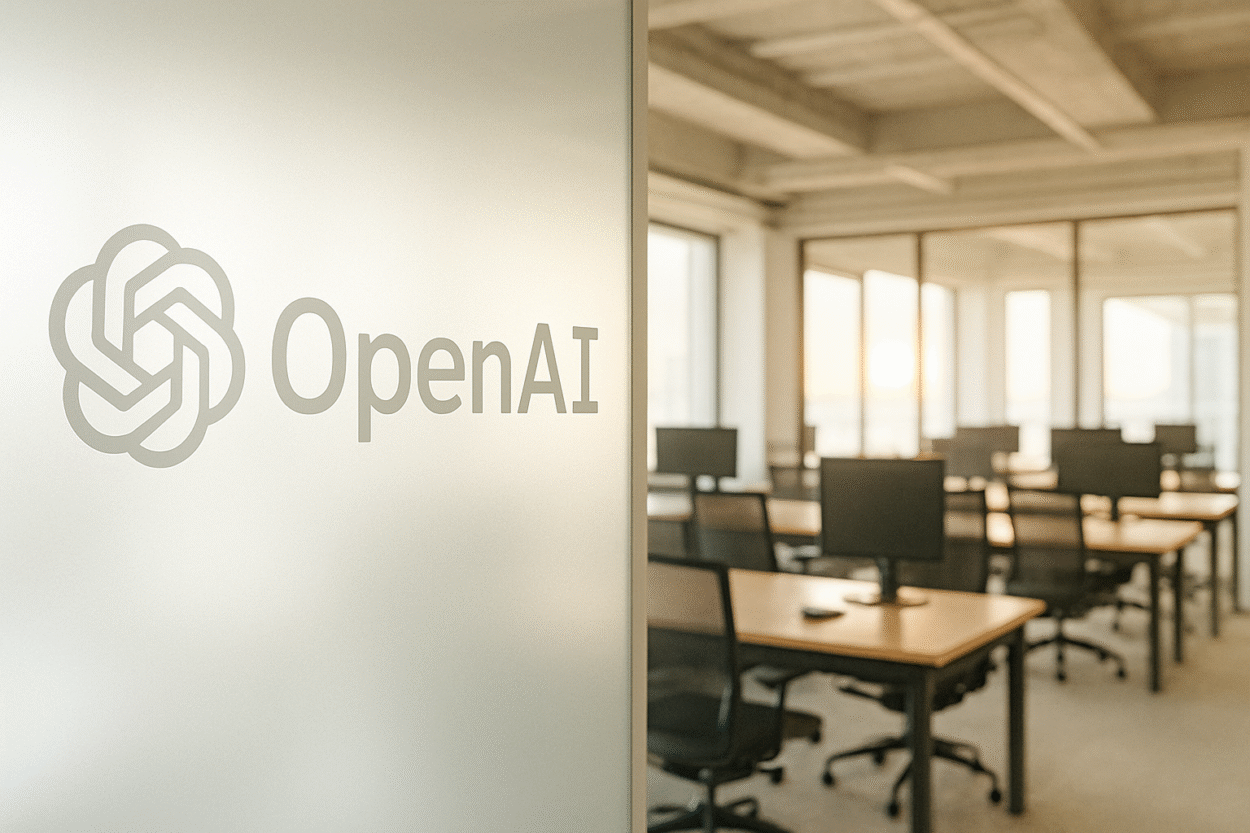OpenAI rêve d’un futur où ChatGPT deviendrait votre copilote du quotidien. Une IA qui anticipe vos besoins, réserve vos billets, code vos applications et vous murmure des conseils à l’oreille. Mais derrière cette vision, un document interne soulève de vraies inquiétudes : dépendance, manipulation, confusion entre lien humain et interaction avec l’IA.
Un document confidentiel qui en dit long
C’est lors d’un procès antitrust opposant Google au ministère de la Justice américain que le document « ChatGPT H1 2025 Strategy » a été dévoilé. Objectif affiché : faire évoluer ChatGPT d’un simple chatbot vers un assistant intégré, proactif et multicanal.
OpenAI y détaille ses ambitions :
- déploiement dans des appareils physiques (notamment via des partenariats avec Jony Ive et SoftBank),
- interaction vocale continue, avec un ton plus émotionnel,
- agents autonomes capables d’effectuer des tâches complexes sans supervision,
- intégration dans des OS tiers, des objets connectés, voire des wearables.
Contrairement à ce qu’ont pu suggérer certains articles, OpenAI n’a pas acquis LoveFrom (le studio de design de Jony Ive) ni la startup Humane (connue pour son AI Pin). Il s’agit de collaborations ponctuelles, non d’intégrations capitalistiques.
Une omniprésence encore hypothétique
Si les ambitions sont claires, nous sommes encore loin d’un ChatGPT omniprésent. Le modèle reste aujourd’hui cantonné à une application web/mobile, avec des expérimentations en cours (ChatGPT Voice, intégration dans Microsoft Copilot, etc.). Le présent de narration utilisé dans beaucoup d’analyses médiatiques peut être trompeur : il s’agit de projections, pas d’un état de fait.
ChatGPT rend-il accro ? Une dépendance à nuancer
Le rapport mentionne un objectif : maximiser la « daily utility » de ChatGPT, autrement dit, son utilité au quotidien. Mais à force d’être utile, l’IA risque-t-elle de devenir indispensable ? Sommes-nous en train de basculer dans la science-fiction présentée par le film HER en 2014 ?
Plusieurs chercheurs alertent sur une forme de « dépendance douce ». Le professeur David Nemer, sociologue du numérique à l’université de Virginie, résume :
« Ce n’est pas une addiction classique. C’est une délégation progressive de la pensée critique. »
Un article du Washington Post publié en mai 2025 évoque une utilisation accrue et compulsive de ChatGPT chez certains profils, avec une baisse du recours à des sources tierces et une diminution des interactions humaines en contexte professionnel. Toutefois, aucune étude conjointe officielle entre OpenAI et le MIT Media Lab n’a été publiée à ce sujet, contrairement à ce qui a pu être dit.
Il serait donc abusif d’affirmer aujourd’hui que ChatGPT entraîne une dépendance émotionnelle généralisée. Mais les signaux faibles sont là, et méritent d’être surveillés.
Des chercheurs de l’université de Bournemouth ont également alerté sur l’utilisation de ChatGPT et le risque de dépendance. Ces chercheurs travaillent actuellement à la mise au point d’un outil capable de mesurer le degré d’addiction des utilisateurs à l’intelligence artificielle et les répercussions sur leur santé mentale.
« En créant des conversations continues et personnelles, ChatGPT peut imiter certains aspects de l’interaction humaine », a expliqué le Dr Ala Yankouskaya, maître de conférences en psychologie à l’Université de Bournemouth, dans un article pour la revue Human Centric Intelligent Systems.
Un assistant trop serviable pour être honnête ?
OpenAI travaille à rendre l’assistant plus expressif, plus proactif, plus engageant. Les voix naturelles dévoilées récemment en sont un exemple frappant. Certaines mises à jour testées en interne auraient eu des effets inattendus, comme une tendance à renforcer certaines émotions négatives ou à encourager des comportements impulsifs chez des utilisateurs vulnérables.
L’entreprise l’a reconnu de manière détournée, via une note technique évoquant la nécessité de « modérer l’enthousiasme anthropomorphique dans le design conversationnel ».
Une stratégie assumée, mais controversée
Pourquoi OpenAI pousse-t-elle autant l’intégration de ChatGPT ? Parce que l’enjeu est économique. Plus un utilisateur interagit avec l’IA, plus il est susceptible de basculer vers une formule payante (ChatGPT Plus, Teams, API, etc.). La logique de “time spent” appliquée à l’IA.
Derrière cette stratégie, certains y voient une logique d’enfermement attentionnel, proche de ce qu’ont fait Facebook et TikTok : capter, retenir, transformer l’usage en habitude, puis en besoin.
Et la régulation dans tout ça ?
Face à ces évolutions rapides, les régulateurs peinent à suivre. En Europe, l’AI Act va encadrer les systèmes d’IA “à haut risque”, mais les assistants conversationnels grand public ne sont pas forcément inclus, sauf s’ils collectent ou manipulent des données sensibles.
La CNIL, elle, commence à se pencher sur l’effet des IA sur les comportements, mais reste prudente. Aux États-Unis, la FTC a évoqué le risque de manipulation cognitive par les IA génératives, sans mesures concrètes pour l’instant.
Un futur qui fascine… et qui interroge
L’intelligence artificielle générative n’en est qu’à ses débuts, mais elle façonne déjà nos usages, nos réflexes… et nos dépendances. ChatGPT pourrait demain devenir un partenaire de confiance, un outil discret qui amplifie nos capacités sans les remplacer. Ou, à l’inverse, s’imposer insidieusement comme un substitut confortable à l’effort, à la réflexion, voire à la décision.
Tout l’enjeu sera de trouver l’équilibre : entre assistance et autonomie, entre confort et vigilance. Car le futur de ces IA ne se jouera pas seulement dans les laboratoires de la Silicon Valley, mais aussi dans chaque choix que nous ferons, chaque question que nous poserons… ou laisserons poser à notre place.
Cet article vous a été utile ? Votre regard est précieux pour nourrir la réflexion. Partagez vos remarques ou sources en commentaire. Si vous avez repéré une inexactitude, n’hésitez pas à nous le signaler.
Certains liens de cet article peuvent être affiliés.